Glossaire de la Photographie
Découvrez les différentes techniques de la photographie
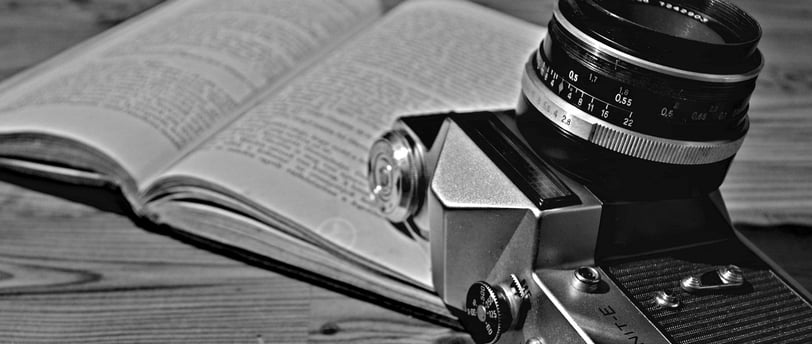

L'univers de la photographie et de ses techniques est vaste si bien que l'on peut se retrouver perdu parmi tous les termes utilisés.
Ce glossaire est ici pour vous aider à vous familiariser avec les différentes techniques de tirage.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Autochrome
C'est du moyen indirect de la trichromie énoncé par Cros et Ducos du Hauron qu'est issu le premier procédé industriel de photographie des couleurs, commercialisé par Lumière sous le nom d'Autochrome en juin 1907. Une plaque de verre sur laquelle on dépose un filtre-mosaïque trichrome (rouge-orange, bleu-violet, vert) constitué de grains de fécule de pomme de terre puis un vernis puis la couche de gélatino bromure d'argent photosensible. La couche image est doublée d'une seconde plaque de verre pour la protéger. Cette image est unique.
Daguerréotype
Ce procédé, mis au point par L.J.M. Daguerre, est présenté le 7 janvier 1839 par le savant F. Arago, qui n'en dévoile officiellement le secret que le 19 août 1839, lors d'une réunion à l'Institut, devant l'Académie des sciences et l'Académie des beaux-arts.
Le daguerréotype est une image positive directe, obtenue sur une plaque de cuivre couverte d'une couche d'argent et soigneusement polie. Celle-ci est rendue sensible à l'action de la lumière par des vapeurs d'iode, qui forment de l'iodure d'argent sur la surface polie. La plaque doit alors être utilisée rapidement. Le temps de pose, pour la prise de vue, est d'environ 15 minutes, par temps clair. La plaque est ensuite développée, à l'abri de la lumière, par des vapeurs de mercure, puis fixée à l'aide d'hyposulfite de soude, et lavée à l'aide d'eau distillée.
Le daguerréotype est une œuvre unique.
Dye-Transfer
Ce procédé permet une conservation de la couleur extrêmement durable mais sa fabrication coûte cher. Technique d’impression couleur papier issue du trichrome au charbon. Ce procédé possède la qualité d’un rendu maximum des couleurs. Découverte au milieu des années 70 par William Eggleston ou inventé par Kodak, le « dye-transfer » est un transfert hydrotypique mis en œuvre pour le tirage de positif couleur sur papier. Procédé extrêmement lent et délicat, il permet un véritable éclat des couleurs qui se rapproche des pratiques artisanales picturales. Malgré cette complexité opératoire il reste le procédé le plus élaboré utilisé jusqu’à ces dernières années car les colorants utilisés sont bien plus solides que ceux couramment utilisés dans les émulsions à couches superposées. Le tirage hydrotypique présente néanmoins de nombreux avantages : images transparentes, emploi de pellicules de structure simple, travail à la lumière du jour.
Calotype (négatif papier)
Le calotype est breveté par W.H.F. Talbot en 1841 et utilisé pendant une décennie, avant d'être progressivement remplacé par des méthodes sur verre à l'albumine et au collodion humide.
Le calotype est une feuille de papier dont on enduit une surface, au pinceau, d'une solution de nitrate d'argent. Une fois séchée, cette surface est immergée dans une solution d'iodure de potassium pour permettre la formation de l'iodure d'argent (nécessaire à la sensibilisation du support). Pour utiliser cette feuille comme surface sensible, on l'enduit d'un mélange de gallonitrate d'argent, puis on l'introduit, séchée ou humide, dans un châssis pour l'exposer. On développe ensuite le négatif avec du gallonitrate d'argent avant de le laver et de le fixer dans un bain d'hyposulfite de soude. Le négatif calotype permet d'obtenir pour la première fois plusieurs tirages d'une même image.
Carte de visite - Carte cabinet
Ce fut Edouard Disdéri qui déposa, en 1854, le brevet d'un cliché à dix épreuves réalisées avec un appareil à dix objectifs (par la suite, les appareils eurent plutôt, le plus souvent, quatre ou six objectifs) avec lequel on obtenait dix portraits identiques ou légèrement différents selon l'utilisation qu'on faisait d'un châssis fixe ou mobile. Ce procédé réduisit le coût des manipulations car, à partir d'un seul tirage, plusieurs portraits, mais obtenus à partir d'une seule plaque, étaient découpés (6 x 9 cm) et collés au verso des cartes de visite. La trouvaille de Disdéri ouvrit les portes à une production en grande série de portraits à la portée de nombreuses bourses.
Les cartes cabinet ont un format 12 x 18 cm.
Collodion humide (négatif sur verre)
Inventé en 1848 par l'Anglais F.S. Archer, le procédé au collodion humide apparaît publiquement en novembre 1851. Ce procédé négatif sur verre est le plus populaire jusqu'en 1880, où la plaque à la gélatine sèche vient le supplanter.
Malgré de nombreux inconvénients - le poids et la fragilité du verre ; la difficulté d'appliquer le collodion dans l'obscurité et de développer la plaque impressionnée avant qu'elle ne soit sèche ; l'obligation de transporter une chambre noire portative, les produits chimiques et l'appareil lui-même -, les avantages de ce procédé sont si grands qu'ils compensent les difficultés de l'opération. La finesse du grain et la clarté de ses blancs permettent d'obtenir une grande précision dans les détails et un large éventail de tonalités, autant de caractères que des portraitistes tels que Nadar ou Carjat ont su porter à leur plus haute expressivité esthétique.
Cibachrome (ou Ilfochrome ou dye destruction print)
Procédé de tirage d'épreuves photographiques en couleur, à partir de diapositives, dans lequel les colorants sont incorporés aux couches sensibles du papier au moment de sa fabrication par le fabricant (Ciba-Geigy). Ces tirages sont appréciés pour leurs qualités d’archivage, leur résistance au soleil et la pureté de leur blanc. L'avantage de cette technologie réside dans la possibilité de contrôler les propriétés de pureté et de stabilité à la lumière de ces éléments constitutifs de l'image photographique. Leur maîtrise confère au Cibachrome des qualités uniques. Après exposition, la feuille de papier est développée. La restitution finale des couleurs se fonde sur la plus ou moins grande destruction des colorants présents lors du traitement.
Tirage sur papier albuminé
Il s'agit d'un procédé de tirage le plus courant au XIXe siècle, introduit en 1850. D'une technologie analogue à celle des papiers salés, ils s'en distinguent néanmoins par leur aspect bien particulier. L'albumine, utilisée comme liant des sels d'argent, procure à l'image une structure à deux couches. Elle donne au papier une surface luisante et permet d'obtenir un meilleur contraste.
Tirage argentique ou tirage aux sels d'argent
Un tirage argentique est tiré sur du papier recouvert d'une émulsion contenant des sels d'argent. Ce procédé est utilisé depuis le début du XXe siècle.
Tirages au charbon
l existe un procédé couleur de tirages au charbon qui a été utilisé dès les années 1930 en particulier dans la publicité (Paul Outerbridge et les portraits de stars d'Hollywood). Actuellement en France, la société Fresson de réputation internationale continue à utiliser le procédé au charbon ("tirage Fresson") : Bernard Faucon, Sheila Metzner, Sarah Moon, etc.
Tirage Contact
Epreuve obtenue en mettant le papier sensible en contact avec le phototype négatif ou positif à tirer. L'épreuve contact a les mêmes dimensions que le négatif.
Tirage C-Print ou Color Print
Tirage sur papier fait à partir d’un négatif couleur, un procédé Kodak très répandu par sa haute qualité
Tirage Diasec ©
Procédé et marque d’un support rigide pour contrecoller les tirages. Le tirage est collé par sa face image contre une plaque de méthacrylate transparente et anti UV. Une plaque d'aluminium est collée au verso du document pour le protéger.
Sur le plan technique, le Diasec© est plus résistant que le verre, l’œuvre bénéficie ainsi d’une protection maximale contre les rayons UV, les risques de rayures ou encore d’ondulation de l’image. Sur le plan artistique, le contraste et les couleurs sont magnifiés et les détails les plus fins accentués. Cela donne à l’œuvre une nouvelle profondeur ainsi qu’une netteté et une intensité inégalées.
Tirage Dibond ©
procédé et marque d’un support rigide pour contrecoller les tirages. Il consiste à insérer une couche de polyéthylène de couleur noire entre 2 plaques rigides externes en aluminium, l’ensemble étant à la fois épais, léger et rigide, protégé contre les UV et l'humidité, il est imputrescible et inoxydable et garant de longévité. L’œil est en contact direct avec l’œuvre, la matière et la texture du papier. Sa tenue à la lumière, à la température, à l’humidité et au feu est excellente sa stabilité dimensionnelle, sa surface très plane, son faible poids en font le support incontesté des œuvres à conserver.
Tirage Fresson ©
Le procédé au charbon direct repose sur le principe élaboré en 1899 par Théodore-Henri Fresson : une couche de gélatine sensibilisée au bichromate de potassium ou d’ammonium devient insoluble lorsqu’elle est soumise aux UV, cette insolubilité étant proportionnelle à la quantité de lumière reçue. Cette propriété subsiste si, à ce mélange de gélatine et de bichromate alcalin, sont ajoutées des couleurs indélébiles. Ainsi, à la lumière sous un négatif, les parties correspondantes aux transparences du cliché seront insolubles, tandis que les parties cachées par les opacités du cliché resteront solubles. Il en résultera une image positive comprenant la gamme allant du noir au blanc en passant par les demi-teintes intermédiaires.
Tirage jet d’encre (ou ink jet)
Impression numérique du tirage par une imprimante jet d’encre ; ces encres peuvent être liquides ou de pigments. Ce procédé sans contact peut s'utiliser sur différents supports : papier, matière plastique, toile... Avec ce procédé, une goutte ou un jet continu d’encre liquide est évacué de son réservoir grâce à un phénomène de surpression. La qualité d'impression dépend donc de la technique mais aussi de la qualité de l'encre utilisée et du support d'impression choisi.
Tirage Lambda
Tirage d’un cliché fait sur papier photosensible à partir d’un projecteur laser de marque Durst Lambda. Ce procédé est considéré comme la technologie numérique la plus avancée, pour produire des images sur papier argentique à partir d'un fichier numérique. Les tirages lambda produisent des photos d'une précision inégalable, des tons continus et un rendu naturel des couleurs.
Tirage Laser
impression numérique laser reproduit des compositions de textes et graphiques, avec des fontes de caractères variées et des images tramées. Les imprimantes laser utilisent une poudre noire, le toner.
Les avantages de l’impression laser sur l’impression à jet d’encre, comprennent une meilleure résolution, l’absence d’éclaboussures, et un coût plus faible. La vitesse d’impression est plus rapide, car la page est traitée directement dans son ensemble, alors qu’un dispositif jet d’encre imprime une série de bandes étroites rapprochées. Cependant, les imprimantes numériques laser noir et blanc produisent toujours des images tramées et, sauf les modèles haut de gamme, sont moins performantes dans la reproduction d’images à ton continu telles que les photographies.
Il existe des papiers conçus spécifiquement pour l’impression numérique au laser : des papiers avec une surface ultra-lisse et une brillance élevée qui procurent un meilleur rendement sur presse et des résultats optimaux. Comme la versatilité des couleurs est limitée en comparaison d’une impression offset, l’impression numérique au laser n’est pas recommandée pour les travaux où l’exactitude de la couleur est déterminante.
Tirage offset
Procédé d’impression utilisant un transfert de l’image originale sur un rouleau, qui sert ensuite à imprimer des feuilles de papier
Tirage sur papier salé
Les épreuves sur papier salé (1839-1860) sont obtenues par noircissement direct par contact avec le négatif. La préparation des papiers s'effectue par un salage suivi d'une sensibilisation au nitrate d'argent. Les papiers salés sont plus ou moins mats. Dès les années 1840, les épreuves ont pu être virées dans une solution de chlorure d'or. Leur tonalité à l'origine brun orangé devenait alors plus froide, variant selon la composition du bain et le temps du virage.
Tirage platine
Tirage argentique viré au platine de très grande qualité
Rayogramme
Voir Photogramme
Vues Stéréoscopiques
Il s'agit de deux photographies d'un même sujet, prises de points de vue différents et se prêtant à la projection stéréoscopique ou examen au stéréoscope (vision du sujet en relief par l'observation binoculaire). On trouve des daguerréotypes, des négatifs sur verre et des tirages sur papier.
Photogramme / Rayogramme
Les photogrammes sont des épreuves photographiques réalisées en laboratoire, sans appareil, en posant des objets directement sur le papier sensible. Les objets arrêtant la lumière, leurs contours apparaissent en clair sur fond sombre.
Photoglyptie
Inventée par W.B. Woodbury en 1865, la photoglyptie est le seul procédé de reproduction photomécanique à posséder des gradations de tons continues, et donc à être difficile à distinguer des images photographiques (notamment des tirages au charbon). D'une très grande qualité, il a été utilisé, jusqu'au début du siècle, surtout pour fournir des illustrations de livres.
Polaroid
Ce procédé, inventé en 1947 par l'Américain Edwin H. Land, donne en quelques secondes une épreuve positive sur papier. Fonctionnant d'abord seulement avec des appareils de la marque Polaroid, il devient ensuite utilisable en moyen et grand format grâce à des dos adaptables. On trouve des polaroids de format 50 x 60 cm qui sont des épreuves uniques réalisées à l'aide d'une seule machine exceptionnelle qui circule en Europe pour promouvoir l'art photographique.
Héliogravure
Reproduction photomécanique dérivant des méthodes de la gravure en creux ; imprimée sur presse en taille douce, l'héliogravure a été mise au point à partir des travaux de Nièpce, Talbot, Baldus puis Charles Nègre, avant que son application commerciale ne se développe grâce aux modifications apportées par Karel Klic en 1880. Les tirages parus dans la revue Camera Work de 1903 à 1917 sont appelés photogravures, certains sont reproduits sur papier Japon.
Gélatino-bromure d'argent
A la suite des travaux publiés par Richard Leach Maddox en 1871, le gélatino-bromure d'argent remplace progressivement, à partir de 1880, la majorité des techniques antérieures, surtout pour le négatif.
Les émulsions sont sensibilisées en usine et vendues prêtes à l'emploi.
Trois types principaux de supports ont été employés :
les plaques de verre pour images négatives ou positives ;
les supports souples pour négatifs ;
les papiers pour épreuves positives, dont la tonalité est noir neutre après un développement de l'image latente, mais qui peut être modifiée à la suite d'un virage. La sensibilité du gélatino-bromure autorise les tirages par agrandissement de l'image négative.
